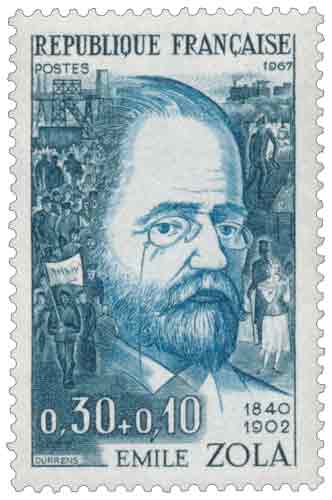Timbre : ÉMILE ZOLA 1840-1902
Timbre : ÉMILE ZOLA 1840-1902 : Émile Zola naît à Paris le 2 avril 1840, durant un séjour de ses parents par ailleurs fixés à Aix-en-Provence où son père, d'origine vénitienne, exerce les fonctions d'ingénieur civil; l'enfant n'a pas encore sept ans lorsque s'amorce, pour sa mère devenue veuve, une longue période de difficultés matérielles auxquelles elle essaie de mettre un terme en venant s'installer dans la capitale au début de 1859. Cela commence assez mal pour le jeune Zola: en effet, il échoue au baccalauréat en novembre et, afin de lutter contre la misère et l'incertitude du lendemain, doit accepter de très modestes emplois dans l'Administration ou aux Docks; il cherche alors une consolation à la dure réalité en s'adonnant à sa passion pour la poésie. Bientôt, la chance tourne: sa trilogie l'Amoureuse Comédie, recueil de longues pièces comptant au total quelque 10 000 vers d'inspiration romantique, vaut à ce poète idéaliste de 22 ans, employé à la manutention par la Librairie Hachette, d'être muté dans les services de publicité dont il ne tarde guère à prendre la direction. Dès lors, non seulement le cours de sa fortune est changé, mais il s'initie à la vie artistique parisienne, côtoie des écrivains en renom: Edmond About, Sainte-Beuve, Michelet, Prévost-Paradol, Taine et, un peu envieux de leur popularité, décide de renoncer à la rime pour ne plus écrire qu'en prose. Le succès de ses deux premières œuvres, un recueil de nouvelles, Les Contes à Ninon, et un roman autobiographique, La Confession de Claude, le confirment dans sa décision; en 1866, il quitte définitivement la maison Hachette pour se consacrer exclusivement au journalisme et à la littérature. D'abord dans Le Petit Journal et Le Salut Public de Lyon, ensuite dans divers journaux tels L'Événement, Le Figaro, Le Gaulois, Le Rappel, La Cloche, ses articles révèlent un Zola polémiste, peu soucieux de heurter les préjugés et opinions les plus solidement établis, ardent défenseur des modes nouveaux d'expression de la pensée : critique littéraire, en dépit de l'engouement du public pour le romantisme., il soutient sans réserve les auteurs réalistes, Flaubert, Daudet, les frères Goncourt; critique du Salon de 1866, lui pour qui l'œuvre d'art est d'abord« un coin de la création vu à travers un tempérament» prend fait et cause pour Edouard Manet et les peintres réprouvés du Café Guerbois, les futurs « impressionnistes ». Mais, si ses articles lui valent de nombreux sarcasmes, deux nouveaux romans -Thérèse Raquin (1867) et Madeleine Férat (1868) -vont proprement soulever le tumulte. Zola ne s'en émeut guère et conçoit au contraire, sur le modèle de la Comédie Humaine de Balzac, son projet d'une « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire» : les Rougon-Macquart. Acquis aux conceptions déterministes de Taine, séduit à la fois par le positivisme d'Auguste Comte et la méthode expérimentale de Claude Bernard, Zola entreprend, dès 1869, une série d'enquêtes sociologiques afin de rassembler les documents nécessaires à l'édification de son œuvre. Fidèle à sa devise empruntée à Pline« Nulla dies sine linea» (Pas un jour sans une ligne), il met son extraordinaire puissance de travail et toute la fertilité de son imagination au service de cette vaste fresque sociale et, tout au long des vingt livres qui la constituent, décrit, avec une rare précision dans les détails, les milieux bourgeois, financier, ouvrier, commerçant, ecclésiastique, paysan, politique, militaire, artistique, dans lesquels il fait vivre plus d'un millier de personnages. En 1877, quand paraît le septième volume L'Assommoir, la critique jusque-là dédaigneuse se déchaîne brutalement contre cette littérature qu'elle qualifie de « putride»; aussitôt, les partisans de l'école naturaliste se regroupent et, au COurs des « Soirées de Médan», précisent les caractères du roman expérimental, repris par Zola dans cinq ouvrages de doctrine à partir de 1880. Les titres, aujourd’hui prestigieux, se succèdent alors à cadence rapide: Nana (1880), Pot-Bouille (1882), Germinal (1885), La Terre (1888), La Bête Humaine (1890), La Débâcle (1892). L'année où paraît le dernier des Rougon-Macquart, Le Docteur Pascal (1893), Zola - depuis deux ans déjà président de la Société des Gens de Lettres - se voit promu officier de la Légion d'Honneur. La consécration officielle ne met pas pour autant un terme à sa carrière littéraire: au contraire, ses contacts avec te monde ouvrier l'ayant ini6é au socialisme, il met son génie visionnaire au service de sa foi sociale et, après la série des Trois Villes -Lourdes, Rome, Paris -(1894-1898), il exprime son optimisme dans le cycle des Quatre Évangiles Fécondité, Vérité, Travail, Justice (ce dernier resté inachevé). Zola est au faîte de la gloire quand éclate l'Affaire Dreyfus. Il prend parti et, après ses Lettre " la Jeunesse et Lettre à la France, écrit une Lettre au Président Félix Faure que Georges Clemenceau publie le 13 janvier 1898 dans son journal, L'Aurore, sous le titre fameux« J'accuse »; condamné pour « outrages à l'armée» à un an de prison et 3 000 francs d'amende, Zola est contraint de s'exiler en Angleterre; il revient en France en juin 1899, après avoir appris la grâce de Dreyfus; malheureusement, il meurt accidentellement trois ans plus tard, le 29 septembre 1902, trop tôt pour savourer la joie que lui aurait procuré la reconnaissance officielle de l'innocence du capitaine - en 1906 -, innocence à laquelle il avait tellement cru et pour laquelle il avait tant risqué qu'Anatole France pouvait justement dire, lors de la cérémonie des funérailles nationales qu'à l'occasion de cette douloureuse Affaire Dreyfus, Zola avait été « un moment de la conscience humaine».
Année : 1967
Yvert & Tellier n° 1511
Categorie : Timbres poste
Famille : écrivains
Dessinateur : Claude Durrens
Valeur neuf MNH ** : 0.15 €
Valeur oblitéré : 0.15 €